Le pont entre un jour férié et un week-end: questions-réponses
Le pont est défini par le code du travail comme le « chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels » (article L3122-27).
- Un salarié peut-il exiger de bénéficier d’un pont ?
Non. L’employeur n’est pas obligé de donner le pont aux salariés même si la majorité d’entre eux en fait la demande, excepté si un accord collectif ou des dispositions conventionnelles le prévoient.
- Un salarié peut-il chômer un pont de sa propre initiative ?
Non. La décision de « faire le pont », qui entraîne une modification temporaire de l’horaire de travail, appartient exclusivement à l’employeur .
- La journée de pont doit-elle être payée par l’employeur ?
Non, excepté si la convention collective applicable à l’entreprise le prévoit ou bien si cela résulte d’un usage dans la profession ou dans l’entreprise.
- Les heures perdues lors d’une journée de pont sont-elles récupérables ?
Oui. Cela est expressément prévu par l’article L3122-27 du code du travail: les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail peuvent être récupérées.
La récupération a été définie comme un dispositif qui permet de considérer comme heure déplacée, et non comme heure supplémentaire, des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale, en compensation d’heures de travail perdues du fait de circonstances exceptionnelles (Circulaire DRT n°94-4 du 21 avril 1994, Bulletin officiel Travail n°94-9).
Les heures récupérées sont donc payées au taux normal, sans majoration de salaire sauf dispositions conventionnelles plus favorable.
Mais elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement de plus d’une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine (article R3122-5).
La semaine où a lieu la récupération, le salarié peut être amené à effectuer des heures supplémentaires. Le principe est que les heures de récupération sont effectuées en premier, au taux normal, après les heures normales de travail mais avant les heures supplémentaires (Circulaire DRT N°41/53 du 24 avril 1953).
Exemple: un salarié est employé sur la base de 35 heures et doit récupérer quatre heures dans la semaine; il va par ailleurs effectuer 3 heures supplémentaires: les 35 heures habituelles et les 4 heures de récupération seront payées au taux normal et les 3 heures supplémentaires seront majorées, en principe, à 25% sauf dispositions conventionnelles différentes.
La récupération doit avoir lieu dans les douze mois précédant ou suivant le pont (article R32122-4) sauf si un accord collectif prévoit une durée plus longue ou plus courte.
La récupération de la journée de pont entraîne une modification de l’horaire collectif; elle doit donc faire l’objet de plusieurs préalables: l’information de l’inspecteur du travail (article R3122-4) ; la consultation du comité d’entreprise sauf s’il s’agit d’une initiative limitée dans le temps et immédiatement assortie du principe de la récupération des heures perdues (Cass. soc. 9 juillet 1986 n°85-41861); l’affichage de l’horaire modifié (article L3171-1).
Lorsqu’un jour férié est situé au milieu d’une semaine, par exemple le mercredi et qu’une entreprise décide de faire chômer son personnel le lundi et le mardi précédant, ainsi que le jeudi et le vendredi suivant, occasionnant ainsi des heures perdues, elle doit faire un choix et ne peut faire récupérer qu’un seul des deux ponts; l’autre doit être indemnisé (Cass. soc. 18 mai 1999 n°97-13131).
- L’employeur peut-il déduire les journées chômées pendant un pont (sauf les jours fériés) du congé annuel ?
Non. Cela n’est pas autorisé car l’employeur dispose d’une faculté de récupération des ponts; il ne peut donc pas imputer une journée chômée sur le congé payé, auquel le travailleur a droit en considération de son travail effectif (Cass. soc. 17 avril 1986 n°83-45788).
Voir les articles connexes
- Retour de congé parental: le salarié doit retrouver son précédent emploi excepté si celui-ci n’est plus disponible
- Temps partiel : au 1er janvier 2014, la durée minimale est fixée à 24 heures par semaine
- Pauses au travail : quelles sont les règles en 2020 ?
- Preuve des heures supplémentaires: mode d’emploi
- Congé sans solde, congé sabbatique: quelles sont les règles ?
- La neige bloque mon train : mon employeur peut-il me sanctionner ?
- Un congé paternité spécifique de 30 jours en cas d’hospitalisation de l’enfant après la naissance
- Activité en journée continue : comment organiser son temps de travail et les pauses ?
- Il neige: que faire quand la météo nous joue des tours?
- Les salariées qui ont recours à la PMA bénéficient d’autorisations d’absences rémunérées


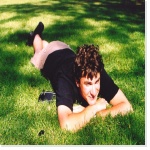
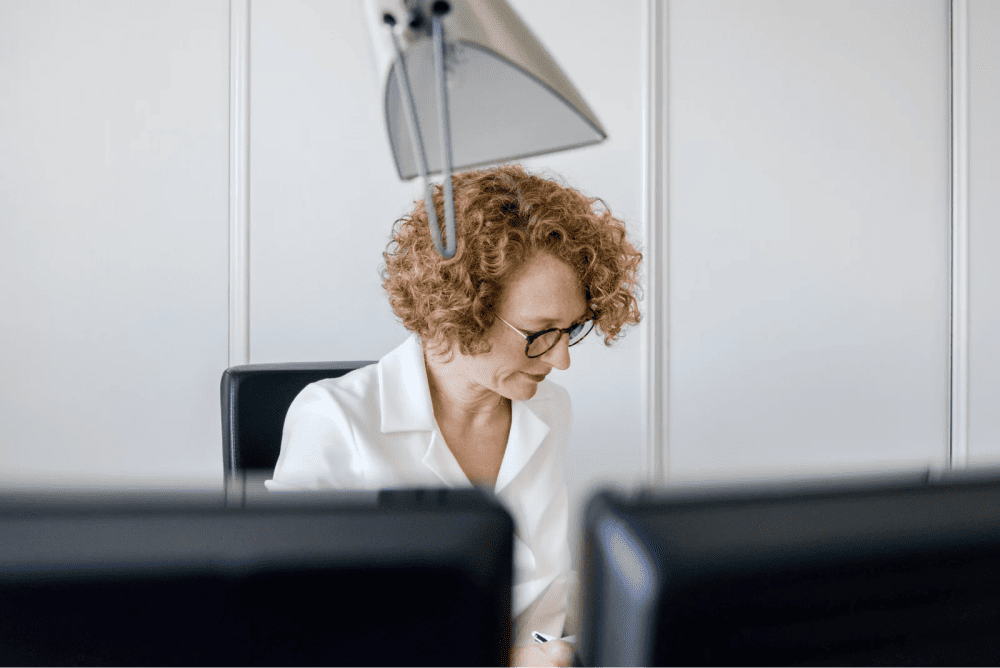






Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaires (3)