La transaction en droit du travail : les points de vigilance (volet 2 / 2)
Dans la dernière lettre d’actualité de la CPME NORMANDIE, Maître Lailler évoque les points de vigilance lorsqu’on transige en droit du travail.
Un premier article du blog a été consacré aux situations dans lesquelles la transaction peut intervenir.
Ce second volet est consacré aux conditions de validité et aux effets de la transaction.

La transaction est fréquemment utilisée pour mettre fin à un litige entre employeur et salarié.
Une certaine vigilance s’impose néanmoins afin que cette transaction soit valide.
A défaut, lanullité de la transaction peut être invoquée par le salarié.
- Les conditions de validité de la transaction
Elles ont été précisées par la jurisprudence et concernent trois points principaux :
1) la date de conclusion de la transaction
la transaction qui met fin à un différend relatif à la rupture doit obligatoirement intervenir après la rupture définitive du contrat ; et si la transaction intervient après un licenciement, la Cour de cassation a jugé que le licenciement doit obligatoirement avoir été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, à défaut, la transaction est nulle (Cass. Soc. 10 octobre 2018). La transaction n’est en outre valable que si elle est postérieure à la réception de la lettre recommandée par le salarié.
Il n’est pasnécessaire en revanche d’attendre la fin du contrat pour transiger ; dèslors que la notification de la rupture est intervenue, on peut transiger pendant le préavis (Cour d’appel de Versailles –11 septembre 2001 – 15ème ch. soc. n°96-23109).
2) les concessions réciproques entre les parties à la transaction
Ces concessions, qui s’apprécient au moment de la signature de la transaction, doivent être réelles et avoir un objet licite ; en cas de contentieux, les juges contrôlent le contenu des concessions, et regardent quelles étaient les prétentions des parties et quel est le motif de la rupture. Ils vérifient que les concessions ne sont pas dérisoires et qu’elles procurent un réel avantage à l’autre partie.
Par exemple, il aété jugé qu’il y a absence de concession réciproque si l’employeur verse ausalarié une indemnité transactionnelle équivalente à l’indemnité de préavisalors que les faits reprochés ne peuvent être qualifiés de faute grave (Casssoc. 2 mars 2011 n°09-41185).
De même lorsque lesalarié reçoit une indemnité transactionnelle d’un mois et demi de salairealors qu’il renonce à toute contestation de son licenciement et acceptel’insertion d’une clause de non-concurrence dans la transaction (Cour d’appelde Metz 11 janvier 2010, n°07/03635).
Il n’y a pas deconcession réciproque lorsqu’un employeur renonce à porter plainte pour volcontre le salarié licencié pour faute grave et à demander l’indemnisation dupréjudice qu’il a subi, alors que le salarié est privé de toute indemnité etrenonce à contester son licenciement (Cass. soc. 13 octobre 2011 n°09-71829).
A savoir : onpeut transiger sur l’intérêt civil résultant d’un délit (un vol par exemple)mais la transaction n’empêche pas la poursuite pénale par le ministère public(article 2046 du code civil).
Certains contentieux ne peuvent fairel’objet de transactions :ainsi toute convention contraire à la législation qui protège les salariésvictimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle estnulle (article L482-4 du code de la sécurité sociale).
Dès lors, est nul un protocole aux termes duquel lesalarié renonce à son action pour faire reconnaître la faute inexcusable del’employeur (Cass. 2ème civ. 1er juin 2011 n°10-20178).
De même, un salarié protégé ne peut renoncer à sonstatut protecteur.
3) le consentement
Les vices du consentement sont une cause de nullité de la transaction. C’est le cas par exemple lorsqu’il y a eu erreur d’une partie sans laquelle elle n’aurait pas accepté la transaction (erreur), lorsqu’il y a eu tromperie, mensonge, ou silence volontairement gardé sur un élément essentiel (dol), ou lorsqu’il y a eu des pressions exercées sur le salarié pour qu’il signe, par exemple des menaces de plainte pour vol (violence).
La transaction peut également être annulée s’il est démontré que le salariéavait une altération de ses facultés mentales, ou se trouvait en situation defragilité psychologique, et qu’il n’était pas apte, dès lors, à prendre ladécision de transiger.
Le salarié peut demander la nullité de latransaction si les conditions de validité ne sont pas respectées ; une telle demande est en revancheimpossible pour l’employeur. (Cass. soc. 28 mai 2002 n°99-43852).
- Les effets de la transaction
« Latransaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les partiesd’une action en justice ayant le même objet» (article 2052 du code civil).

Elle met fin à toutes les contestations qui y sont mentionnées et de manière plus globale à toute demande en justice à laquelle les parties ont déclaré renoncer.
Dans une décisiondu 20 février 2019, la Cour de cassation a confirmé la validité d’une clause de renonciation générale qui précisait que lesalarié « déclarait abandonner demanière définitive toutes autres demandes qu’il aurait formées ou qu’ilpourrait former aux fins d’indemnisation ou de rémunération quel que puisse enêtre le fondement et que les parties renonçaient réciproquement, de façonexpresse et irrévocable, à tous droits, demandes ou actions, pouvant résulterde quelque manière et pour quelque cause que ce soit des relations ayant existéentre eux ainsi que de leur cessation ».
En conclusion :
La transaction permet de mettre fin définitivement à un litige mais il convient d’être particulièrement vigilant lors de la rédaction du protocole.
Voir les articles connexes
- L’indemnité forfaitaire de conciliation est entrée en vigueur le 8 août: elle est calculée selon l’ancienneté du salarié
- La transaction en droit du travail : les points de vigilance (volet 1 / 2)
- Comment préparer une audience aux Prud’hommes
- Conflit persistant entre salariés : l’employeur doit réagir
- Prud’hommes : à compter du 1er août 2016, de nouvelles règles s’appliquent
- Blocages, grèves : que peut légalement faire le gouvernement ?
- Grèves : à quelles conditions peut-on réquisitionner des salariés ?
- Blocage des raffineries : l’action des salariés est-elle légale ?
- Le droit de grève dans le secteur public : un droit encadré
- Prud’hommes : mieux connaître leur fonctionnement avec le site public justice.fr


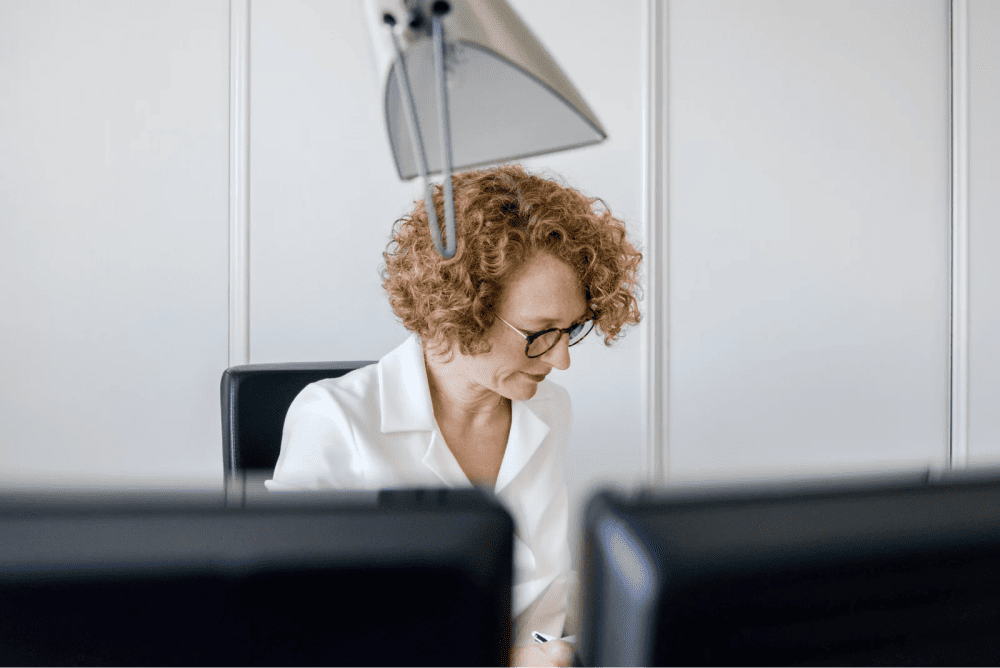






Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaires (1)